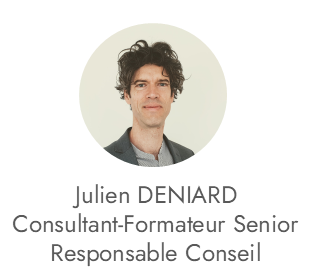Maintien à domicile des seniors : au-delà de l’adaptation « à la demande », une stratégie pro-active est nécessaire !
En 2024, l'ANCOLS a publié une étude consacrée à l’adaptation des logements sociaux au vieillissement et au handicap. Les enseignements de l’étude sont clairs : la question du maintien à domicile des seniors doit désormais figurer comme un axe structurant de la stratégie patrimoniale des organismes. Le chemin reste néanmoins long.

Définir une stratégie claire d’adaptation de son patrimoine constitue pourtant un enjeu d’optimisation de ses investissements et de l’allocation de ses ressources. Ce défi constitue aussi une opportunité : celle de renforcer sa mission sociale, l’attractivité de son parc et son positionnement d’acteur local.
Un constat qui interpelle…
Le vieillissement des habitants est aujourd’hui l’une des évolutions socio-démographiques majeures auxquelles sont confrontés les bailleurs sociaux : plus d’1 logement sur 4 (27%) est occupé par un ménage dont la personne de référence est âgée de 65 ans ou plus [1] (soit plus de 1,25 millions de logements concernés!).
Et cette évolution concerne aussi la demande de logement social, avec une forte proportion de demandeurs issus de la génération du baby-boom (plus de 20% de demandeurs de 55 ans et plus).
Face à cette situation, les résultats de l’étude révèlent un paysage contrasté. Près d’un bailleur sur deux ne connaît pas précisément l’état d’adaptation ou d’adaptabilité de son parc. Cette méconnaissance rend difficile la réponse aux besoins, et plus encore l’anticipation des besoins futurs.
[1] données issues du « Panorama du Logement social » 2025 de l’ANCOLS
Si une majorité de bailleurs affichent une volonté d’agir, la traduction opérationnelle reste inégale. L’étude de l’Ancols établit ainsi une typologie des bailleurs selon leur maturité :
- Les engagés (54 %) qui agissent sur le patrimoine ancien : dont 8 % de « leaders », très avancés, dotés de moyens et d’une stratégie multidimensionnelle.
- Les bâtisseurs (14 %) : qui misent surtout sur la construction neuve, une réponse limitée au regard des volumes produits, et du niveau de loyer, qui n’est pas toujours en adéquation avec les ressources des locataires seniors du parc.
- Les freinés (15 %) et non-engagés (31 %) : soit près de la moitié du secteur, sans stratégie claire, agissant essentiellement ponctuellement, en réponse à des demandes.
Une approche principalement centrée sur la réponse aux demandes d’adaptation
La plupart des bailleurs adoptent une gestion « au fil de l’eau ». L’immense majorité concentre leurs moyens sur le traitement de demandes individuelles d’adaptation, plutôt que sur une stratégie planifiée.
En effet, pour les bailleurs sociaux, l’adaptation à la demande s’inscrit dans une ambition de qualité de service et d’accompagnement des locataires seniors. Elle permet d’apporter une réponse personnalisée, à un besoin immédiat exprimé.
Elle présente néanmoins des limites : les interventions arrivent souvent tard (après une chute ou une hospitalisation, lorsque la perte de mobilité est déjà avérée), et ne sont pas toujours suffisantes pour permettre un maintien à domicile sécurisé à long terme. Les adaptations plus lourdes ne sont quant à elles pas toujours techniquement ou économiquement possibles, ou peuvent nécessiter des travaux de remise en état à la relocation. Les logements ayant bénéficié d’une adaptation ne sont par ailleurs souvent pas répertoriés, ne permettant pas une visibilité globale et maîtrise de l’offre.
Si l’adaptation à la demande est incontestablement utile, elle n’est pas suffisante face à l’ampleur des besoins, dans le parc social et, plus largement, dans les territoires.
Alors, que faire ? S’inspirer des bailleurs les plus avancés
En nous appuyant sur notre expérience – plus de 10 ans d’accompagnement des bailleurs sur le sujet -, nous avons identifié 8 leviers d’action clés:
- Distinguer vieillissement et handicap : les besoins, volumes et types de travaux diffèrent, et doivent être traités par des dispositifs distincts.
- Agir en prévention pour soutenir l’autonomie des seniors : l’adaptation préventive permet de diminuer les risques de chute, première cause de perte d’autonomie. Au-delà de l’intérieur des logements, une réflexion globale est à mener sur les espaces communs, les abords et l’environnement immédiat. Cette offre de logements permettra d’accueillir des séniors encore autonomes qui pourront vivre plus longtemps dans un environnement sécurisé.
- Définir des critères d’intervention clairs et partagés : ces critères doivent permettre d’identifier les logements pertinents à adapter, de faciliter les arbitrages sur les demandes d’intervention et de fixer les orientations et objectifs de développement de l’offre de logements seniors.
- Connaître son parc, identifier les besoins et les opportunités : au-delà de l’identification des logements déjà adaptés, l’analyse du patrimoine doit permettre d’identifier les opportunités d’adaptation, au regard des critères définis : quels sont les logements qui pourraient être adaptés ? Où sont-ils situés ?… L’analyse de l’occupation (et de la demande) permet de préciser la stratégie d’intervention, en identifiant des territoires, secteurs ou programmes prioritaires.
- Définir ses objectifs, sa stratégie et l’intégrer au PSP : les objectifs quantitatifs à court, moyen et long termes, sont à définir en articulant l’ensemble des leviers à disposition du bailleur : la programmation dans le neuf ; l’intervention dans le parc ancien, ciblée au regard de l’analyse du patrimoine et de l’occupation réalisée ; l’adaptation à la demande. L’adaptation du parc au vieillissement doit ainsi s’inscrire comme un axe structurant du Plan Stratégique du Patrimoine.
- Homogénéiser les interventions : recourir à un cahier des charges type pour l’adaptation du logement et des parties communes facilite le déploiement opérationnel, et permet d’assurer traçabilité, cohérence et lisibilité de l’offre. Les référentiels et labels existants, tels que le Label Habitat Senior Services®, peuvent constituer un appui, et aider à la valorisation de l’offre auprès des ménages concernés et des partenaires.
- Assurer la traçabilité de l’offre : l’identification des logements au sein des outils de gestion est fondamentale pour faciliter la relocation à des seniors et répondre à la demande (y compris en termes de mutation), en pérennisant et optimisant les investissements réalisés.
- Former ses collaborateurs et développer une culture partagée : enfin, la sensibilisation des collaborateurs permet d’assurer une compréhension commune des enjeux du vieillissement et de fédérer autour de la démarche. Les mises en situation permettent de mieux appréhender les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes vieillissantes, et les solutions techniques à déployer.
[1] données issues du « Panorama du Logement social » 2025 de l’ANCOLS
Et vous? Où en êtes vous?